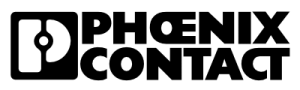Cybersécurité pour les exploitants de parcs éoliens – Pourquoi la sécurité informatique devient une priorité absolue
Pourquoi la cybersécurité affecte aussi les parcs éoliens
Les cyberattaques font depuis longtemps partie de la vie quotidienne. Ce qui concernait auparavant les banques et les grandes entreprises en particulier touche désormais également les parcs éoliens, les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d’énergie. Les infrastructures énergétiques sont une cible attrayante pour les pirates informatiques, que ce soit pour des raisons financières, pour la déstabilisation politique ou simplement parce que les vulnérabilités numériques peuvent être exploitées.
Les parcs éoliens ont depuis longtemps cessé d’être des îlots de puissance isolés. Ils sont intégrés dans un système en réseau numérique de centres de contrôle, de capteurs, d’accès à distance, de logiciels de maintenance et d’applications cloud. Cela rend les systèmes efficaces, mais aussi vulnérables.
En bref, toute personne qui exploite des parcs éoliens doit faire face à la cybersécurité. Pas à un moment donné, mais maintenant.
1. Qu’est-ce que la cybersécurité ?
La cybersécurité fait référence à toutes les mesures prises pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les appareils et les données contre l’accès non autorisé, l’utilisation abusive, le sabotage et la perte de données. Cela s’applique aussi bien aux aspects techniques (par exemple, pare-feu, contrôles d’accès, mises à jour) qu’aux processus organisationnels (par exemple, formations, plans d’urgence, audits).
Dans le cadre des parcs éoliens, on parle de protection :
- Technique de commande et de régulation (par ex. systèmes SCADA)
- du logiciel de gestion des opérations
- des interfaces de communication (par exemple, VPN, accès à la télémaintenance)
- des données des capteurs et des chiffres clés d’exploitation
- des contrats, plans et données personnelles
2. Pourquoi la cybersécurité est-elle particulièrement importante pour les parcs éoliens ?
Les parcs éoliens ne produisent pas seulement de l’électricité, ils font partie des infrastructures critiques (KRITIS). Cela signifie qu’une défaillance peut avoir de graves effets sur la sécurité de l’approvisionnement et l’économie. L’intérêt des cybercriminels pour ces cibles est donc élevé.
Risques typiques pour les exploitants de parcs éoliens :
- Attaques par ransomware : Les systèmes sont cryptés et ne sont libérés que contre une rançon.
- Manipulation des commandes : Sabotage des installations ou alimentation du réseau.
- Vol de données : Les données contractuelles sensibles, les plans techniques ou les données personnelles peuvent être exploités.
- Utilisation abusive de l’accès à la télémaintenance : Accès non autorisé en raison d’interfaces insuffisamment sécurisées.
- Ruptures d’approvisionnement dues à une attaque sur les systèmes de gestion opérationnelle.
Et souvent, un seul système obsolète, un e-mail de phishing ou un accès mal configuré suffisent à causer des dommages massifs.
3. La grande vague de la réglementation : ce à quoi les opérateurs peuvent s’attendre
L’UE et le gouvernement allemand réagissent à l’augmentation des cybermenaces par toute une série de nouvelles lois et directives. L’objectif est d’augmenter considérablement la sécurité informatique dans les domaines d’importance systémique – et de le faire de manière contraignante.
Aperçu des réglementations les plus importantes :
a) Directive NIS 2 (UE)
- Valable depuis janvier 2023 au niveau de l’UE, mise en œuvre nationale jusqu’en octobre 2024
- Directive relative aux mesures visant à assurer un niveau commun élevé de cybersécurité dans l’ensemble de l’UE
- Obligations des entités « importantes » et « essentielles », y compris celles du secteur de l’énergie
- Les entreprises de taille moyenne d’au moins 50 salariés ou d’un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros dans des secteurs critiques sont également touchées
- Fonctions:
- Analyse des risques et mesures de sécurité
- Gestion des incidents
- Plans d’urgence
- Audit de sécurité de la chaîne d’approvisionnement
- Obligation de signaler les incidents dans les 24 heures
- Amendes en cas d’infraction : jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial
b) Loi parapluie KRITIS-KRITIS,
- Complément de l’EEN-2, concerne la sécurité physique des infrastructures critiques
- Les opérateurs doivent sécuriser les actifs critiques contre les dangers naturels, le sabotage et les attaques physiques
- La cybersécurité fait partie d’un concept de protection holistique
- Sera particulièrement pertinent pour les grands parcs éoliens et les gestionnaires de réseau
c) Loi sur la cyberrésilience (CRA)
- Devrait s’appliquer à l’ensemble de l’UE à partir de 2026
- Objectif : Plus de cybersécurité pour les produits et logiciels numériques
- Les fabricants et les distributeurs (par exemple, les fabricants de SCADA, les OEM) doivent prouver que leurs produits sont « sécurisés dès la conception »
- Important pour les opérateurs lors de la sélection et de l’utilisation de nouveaux composants
- Les opérateurs peuvent également être touchés indirectement, par exemple par le biais d’obligations de mise à jour
d) Directive sur la résilience des entités critiques (CER)
- Complète NIS-2 avec des exigences pour la résilience des acteurs critiques
- Les opérateurs doivent inclure dans leur analyse des risques tels que les cyberattaques, les attaques physiques, les pandémies, les événements naturels, etc.
- Les obligations de déclaration et les concepts de protection sont obligatoires
e) NIS2UmsuCG / BSIG-E (mise en œuvre allemande de NIS-2)
- Projet de loi relatif à la mise en œuvre de la directive NIS 2
- Modifications apportées à la loi BSI (BSIG), en particulier :
- Élargissement du champ d’application
- Plus d’obligations pour plus d’entreprises
- Mise en place d’un registre des entreprises de cybersécurité
- Obligation de désigner une « personne de contact responsable » pour la cybersécurité
4. Obligations spécifiques pour les exploitants de parcs éoliens
La réglementation est complexe, mais elle se résume à quelques points clés. Les exploitants doivent être prêts à répondre aux exigences suivantes :
a) Mettre en œuvre des mesures de sécurité
- Segmentation des réseaux
- Sécurisation des interfaces (VPN, télémaintenance)
- Utilisation de logiciels à jour et mises à jour régulières
- Contrôles d’accès (p. ex., authentification à deux facteurs)
- Concepts d’urgence et stratégies de sauvegarde
b) Gestion des vulnérabilités
- Examen et évaluation réguliers de vos propres systèmes informatiques
- Scans de vulnérabilité et tests d’intrusion
- Remédier aux risques dans un délai défini
c) Signaler les incidents de sécurité
- Obligation de déclarer les incidents graves au BSI dans les 24 heures
- Documentation des pannes et des tentatives d’attaque
- Mise en place de processus de réponse aux incidents
d) Chaîne d’approvisionnement sécurisée
- Audits de cybersécurité des prestataires et fournisseurs
- Contrats avec des normes minimales
- Analyse des risques au niveau de la supply chain
e) Sensibiliser les employés
- Formation sur le phishing, la sécurité des mots de passe, le signalement d’incidents, etc.
- Instaurer une culture de la sécurité (p. ex. par le biais de campagnes de sensibilisation)
5. Défis typiques dans la pratique
La mise en œuvre de ces exigences n’est pas acquise d’avance. Les exploitants de petits parcs éoliens ou les exploitants en particulier sont confrontés à des obstacles tangibles :
a) Paysages informatiques complexes
De nombreuses plantes ont poussé au fil des ans. Différents fabricants, des systèmes incompatibles, d’anciens logiciels SCADA rendent difficile la création d’une stratégie de sécurité uniforme.
b) Manque de ressources humaines
La cybersécurité est un domaine particulier. De nombreux opérateurs ne disposent ni de leur propre service informatique ni de responsables de la sécurité.
c) Manque de savoir-faire
On ne sait souvent pas quels systèmes sont vulnérables en premier lieu, et encore moins comment ils peuvent être protégés.
d) Systèmes obsolètes
De nombreux parcs éoliens ont des composants en fonctionnement qui n’ont pas été mis à jour depuis 10 ans ou plus, souvent par crainte de pannes.
e) Sur les dépens
Les investissements dans la sécurité informatique coûtent de l’argent, mais de nombreux opérateurs ne voient pas (encore) de retour sur investissement direct.
6. Recommandations : Comment donner un bon départ aux opérateurs
Même si les exigences semblent décourageantes à première vue, vous n’êtes pas obligé de tout faire en même temps. Il est important de procéder de manière structurée et pragmatique :
- Faire le point
- Quels sont les systèmes utilisés ?
- Quels sont les accès (télémaintenance, internet) ?
- Quelles sont les données traitées ?
- Effectuer une analyse de vulnérabilité
- Y a-t-il des logiciels obsolètes ?
- Les systèmes connectés à Internet sont-ils sans protection ?
- Qui a accès à quoi ?
- Mise en œuvre de normes minimales
- Segmentation du réseau
- Gestion des correctifs
- Règles de mot de passe et 2FA
- Plan d’urgence (p. ex., rançongiciel)
- Impliquer les prestataires de services
- Consultez des fournisseurs de services informatiques ou des consultants spécialisés en cybersécurité
- Responsabiliser les directeurs d’exploitation
- Etablir des formations
- Sensibiliser régulièrement les collaborateurs
- Signalement des incidents ferroviaires
- Examiner les exigences légales
- Êtes-vous couvert par le règlement NIS2 ?
- Quels sont les délais et les obligations de déclaration ?
- Nom de la personne de contact
7. La cybersécurité devient obligatoire, mais aussi une opportunité
Oui, l’effort augmente. Oui, cela devient plus technique. Mais : ceux qui agissent tôt ont des avantages. Non seulement en termes de conformité légale, mais aussi en termes de sécurité opérationnelle. Une seule cyberattaque peut coûter des mois, dans le pire des cas, l’existence.
En outre, grâce à un concept de cybersécurité clair, les exploitants augmentent l’attractivité des parcs éoliens pour les investisseurs, les acheteurs et les assureurs, en particulier dans un système énergétique en réseau numérique et basé sur le marché.